|
Johnny |
|||||
|
Une Voix et une Vie pour nos maux |
|||||
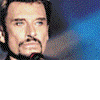 |
Accueil Johnny | Galeries de photos | Les liens |
|
|
| FLASHBACK 2006 | La musique | L'acteur | Le coureur automobile | ||
|
Johnny |
|||||
|
Une Voix et une Vie pour nos maux |
|||||
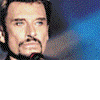 |
Accueil Johnny | Galeries de photos | Les liens |
|
|
| FLASHBACK 2006 | La musique | L'acteur | Le coureur automobile | ||
| Johnny Hallyday, monstre sacré Un phénomène national |
|
| Monté sur scène à 17 ans, il est toujours là, 1 000 chansons plus tard, à l'approche de ses 60 ans. Comme une valeur refuge dans une société sans repères. Pourtant, avec ses amours, ses ruptures, ses copains, ses chagrins, ses syncopes et son rapport vertigineux à l'argent, l'idole cache un cœur tendre. Une star, mais pas de roc Né demi-belge, portant patronyme américain, Johnny Hallyday est une exception culturelle à lui tout seul. Inconnu hors de nos frontières, l'ancien yé-yé passe, en France, pour être l'artiste de tous les records: 1 000 chansons au compteur - dont une petite centaine de tubes - 100 millions de disques et de cassettes vendues, un bon millier de couvertures de magazines, 39 disques d'or. Devenu un phénomène de scène à l'âge de 17 ans, le rocker fêtera son 60e anniversaire, en juin 2003, au Parc des princes. Une modeste cérémonie qui fait, d'ores et déjà, figure de fête nationale. «Il y a dans l'affection très profonde du public pour Johnny Hallyday un phénomène qui va au-delà des sexes et des classes sociales, souligne Jean-Jacques Goldman. Le comprendre nous éclairerait probablement sur nous, Français.» Il a été l'idole des teen-agers, mais de droite quand la jeunesse penchait à gauche. Il affichait des idées «courtes» quand les autres avaient des cheveux longs. Il fut anobli par Godard quand il jouait à Mad Max. Il est sexy pour les uns, ringard pour les autres, goûteux et éternel comme le terroir et pourtant tout le monde l'aime. Mais pourquoi? Il tient, donc. Depuis bientôt quarante- trois ans. Les événements, les modes, les blessures, les passions ont glissé sur lui. Aujourd'hui, les jeunes loups de la variété française s'étriperaient pour lui écrire le tube du siècle, la critique intello consacre l'acteur Hallyday dans L'Homme du train, le film de Patrice Leconte, les politiques le courtisent, les sociologues l'auscultent, les publicitaires l'affichent. Il est loin le temps où Mauriac s'indignait du «delirium tremens érotique» du rocker. Cela fait trois générations que ses chansons tissent le journal intime du pays. Carlos, le chanteur, le pote de toutes les époques: «Johnny, c'est le Victor Hugo de la rengaine. S'il meurt, la France s'arrête.» De Raffarin à Laguiller, de Godard à Zidi, des myopes aux presbytes, tout le monde le clame, désormais: «On a tous en nous quelque chose de Hallyday.» Mais quoi, au juste? «Il offre un corps solide et inaltérable à un pays qui déprime sans se l'avouer, qui n'aime pas beaucoup vieillir et ne sait pas parler de lui», dit à L'Express le sociologue Olivier Mongin, directeur de la revue Esprit. Le psychanalyste Philippe Grimbert évoque sa «stature phallique», tandis que l'architecte Roland Castro insiste sur les failles de l'idole, que l'on a envie de protéger «comme une femme fragile». Johnny hoche la tête pensivement. Il a de petites rides au coin des yeux et la réponse à toutes les questions: «Finalement, ça m'arrangeait bien qu'on me prenne pour un con…» Il est là, silhouette élastique, regard chinois, dans la suite d'un palace parisien où défilent les journalistes. A la vie, à la mort!, c'est le titre de son nouvel album, dont il assure la promotion avec une angoisse à peu près comparable à celle d'un Mike Tyson à qui l'on demanderait d'écraser une mouche. Son précédent opus, Sang pour sang, s'est vendu à 2 millions d'exemplaires. Pour tout dire, Johnny a déjà oublié la moitié des titres des chansons qu'il vient d'enregistrer: «Comment elle s'appelle déjà, celle du prix Goncourt?» Son portable interrompt la séance. C'est Laeticia, sa femme, son «nouvel équilibre», comme disent les magazines féminins. Ce soir, les Hallyday reçoivent. En entrée, il y aura des huîtres en gelée. Johnny conseille. Johnny s'inquiète. «Et comme sauce, tu fais quoi?» Les sauces, c'est son truc. Sa spécialité. Sa raison de vivre, peut-être. A l'âge de 7 ans, dans une ferme, il a avalé, par jeu, des paillettes de savon. Ses papilles ne s'en sont pas remises. Alors, il mange épicé. Très épicé. Avec Carlos et Marc Francelet, un ancien photographe devenu son confident, ils font des concours. A celui qui ramènera de ses voyages la sauce qui tue. Le champion, là aussi, c'est Johnny. «Une fois, à la Lorada, nous étions une douzaine à table, dont Faye Dunaway, raconte Francelet. Il y avait de la salade de crabe. Johnny m'avait préparé un assaisonnement spécial, une sauce noire qu'il avait trouvée en Thaïlande. “Goûte ça, c'est pas mal”, il m'a juste dit.» Et alors? «Ma tête a explosé. Je suis tombé dans les pommes. Devant Faye Dunaway! Johnny, lui, était plié!» Les sauces, les amis. La bande à Johnny. Le premier cercle: Carlos, Francelet, Eddy Mitchell, Jean-Jacques Debout, le parolier Michel Mallory, Jean-Pierre Pierre-Bloch, son ancien secrétaire particulier devenu l'un des lieutenants de Tiberi. Et le second cercle: Vincent Lindon, Bruno Putzulu, Jean Reno… Forcément, on en oublie. Pas lui. L'an dernier, Johnny a proposé à Patrick Balkany, le sulfureux maire de Levallois-Perret, de faire un marché en sa compagnie durant la campagne municipale. Balkany, oui, au mépris du qu'en-dira-t-on. Simplement parce qu'à la fin des années 1960 les deux hommes s'étaient croisés sur le tournage de Qui a tué Raspoutine?, de Robert Hossein, dans lequel le futur élu jouait le rôle d'un prince russe. Le film n'est pas gravé dans les mémoires. Mais les virées en boîte du duo sont restées fameuses. Et l'idole ne lâche jamais un pote en difficulté. Même s'il ne le voit que tous les dix ans. Même s'il imagine le pataquès et la grimace des commentateurs. Dommage que monsieur le Maire n'ait pas voulu le mouiller. Depuis la nuit des temps, ses techniciens le surnomment «l'Homme». Avec une majuscule. C'est comme ça. Carlos se souvient avoir traversé les Etats-Unis en sa compagnie durant sa période biker. Un soir, ils ont poussé la porte d'un saloon bondé, un repaire de coriaces, au fin fond de l'Arkansas. Les cow-boys sont restés la chope en suspens. «Et ça marche aussi à Oulan-Bator, précise Carlos. Les gens ne savent pas qui il est. Mais ils devinent tout de suite que c'est quelqu'un.» Ce magnétisme - que l'âge aiguise plus qu'il ne l'altère - le romancier Claude Klotz s'en est servi pour bâtir le scénario et les dialogues de L'Homme du train. Il ne connaissait pas Hallyday. N'était pas spécialement fan, non plus. «J'ai écrit avec une photo de lui sous les yeux, explique-t-il. Il n'y a pas d'autres acteurs de 60 ans, en France, qui possèdent une telle allure. Il me fait penser à Gary Cooper.» «A l'hôtel, le soir, il refusait que je sorte de sa chambre avant qu'il se soit endormi» On ne reviendra pas sur la légende de l'enfant de la balle, abandonné, déraciné, élevé par sa tante dans le Paris en noir et blanc des années 1950. Une soixantaine de bios s'en sont déjà chargées. Mais il reste, du passé, des cicatrices que l'amour des foules n'a jamais refermées: peur du noir et phobie de l'abandon. Le chanteur Jean-Jacques Debout se souvient de Johnny, à 17 ans, lors de leur première tournée. «A l'hôtel, le soir, il refusait que je sorte de sa chambre avant qu'il se soit endormi. Il s'agrippait à mon cou et me serrait jusqu'à ce que le sommeil l'emporte.» On connaît la suite. Le refus de la solitude, les nuits blanches, les filles, les défonces, la «destroyance» en dialecte Hallyday. «Une chance, note Jean-Pierre Pierre-Bloch, Johnny n'a jamais touché à l'héroïne. Il a peur des piqûres.» Aujourd'hui encore, le chanteur se couche souvent à l'aube. Dans sa maison de Marnes-la-Coquette, la Savannah, il s'est fait installer une salle de cinéma - cadeau de Pascal Nègre, PDG d'Universal Music. «Vers 21 heures, j'attaque, dit Johnny. Un Kazan. Puis un deuxième. Puis un Huston. Puis un Ford. Les bons soirs, je suis capable d'en aligner cinq ou six d'affilée.» De ses multiples vies, la plus récente commence en 1998, avec la sortie de l'album Sang pour sang et l'adoubement tardif de l'intelligentsia. Sagan lui écrit une chanson. Le Monde lui consacre sa Une et un portrait en double page - «Certains trouvaient ça indigne du journal, souligne Pascal Nègre. A l'arrivée, les chiffres de vente ont été pulvérisés.» Miracle: même Les Guignols cessent de matraquer l'idole, chaque soir, sur Canal +. C'est Johnny lui-même qui s'est chargé de corriger le tir. En téléphonant à l'inspirateur irrévérencieux des marionnettes. «Vos conneries, Gaccio, ça me fait plutôt marrer, a expliqué le chanteur. Le problème, c'est pour ma fille, à l'école…» L'autre a branché le haut-parleur. Tout l'étage s'est regroupé autour du téléphone. Ça gueulait: «On t'aime, Johnny!» Gaccio lui-même: «On est obligés. C'est notre métier. Moi, personnellement, je t'adore…» Exit la boîte à coucou. De ce jour, Johnny ne sera plus la risée systématique des Guignols. Un petit «Ah! que…» de temps en temps, à la rigueur. Il y a les artistes que la mort voue vaguement à la postérité. Et il y a Johnny Hallyday. Le culte vivant. Rockstar jusqu'à l'outrance, mais si humain avec ses liaisons, ses ruptures, ses copains, ses chagrins, ses syncopes. Et ses sauces. Dans les années 1960, le comédien Ticky Holgado fut le secrétaire particulier de Claude François puis de Johnny. Le premier ne laissait rien au hasard. Calculait tout au millimètre. Le second, lui, n'agit qu'au feeling. Ne prémédite jamais. Peut tout changer à la dernière seconde. «C'est la frontière entre les grandes vedettes et la star irrévocable, souligne Holgado. Claude se gérait comme un adulte. Johnny, lui, a toujours gardé son âme d'enfant.» Sur scène, Clo-Clo s'épongeait le front entre chaque chanson. Hallyday, icône de chair et de sang, ruisselle comme un forgeron. «Un Johnny qui ne transpirerait pas, ce ne serait plus Johnny», lâche le philosophe Pierre Sansot. Quand on lui parle de l'ancien yé-yé, le photographe Jean-Marie Périer sort l'album de famille des monstres sacrés: «Instinctif, terrien, animal, lâche-t-il. Il me fait penser à Montand.» Signoret et l'engagement politique en moins. Car Johnny est au-dessus des partis. Ni de gauche, comme ses origines modestes ou le mieux-pensant culturel l'auraient voulu. Ni franchement de droite, comme son amitié de vingt ans avec Jacques Chirac pourrait le laisser croire. D'ailleurs, le citoyen Smet n'a plus voté depuis le départ du général de Gaulle. «Ils rêvent tous à leur carrière, glisse-t-il, lui rêvait à la France.» L'artiste a chanté à la Fête de l'Huma comme dans les galas du RPR. Aujourd'hui encore, il n'y a que dans les sauteries du Front national qu'il ne se voit pas allumer le feu. «Les fachos, ça, non… Je ne peux vraiment pas!» A dire vrai, la politique le fait bâiller. Les idéologies l'ennuient. Il n'y a que les hommes et sa fidélité en amitié qui peuvent se targuer de l'encarter. Preuve de son œcuménisme un peu las, le seul dirigeant politique dont il se soit senti proche, avant Chirac, s'appelait Georges Marchais. «J'aimais bien le bonhomme, précise-t-il. On se comprenait.» La rencontre avec Jacques Chirac, alors maire de Paris, remonte au début des années 1980. C'est Line Renaud qui a fait les présentations. Entre les deux hommes, une vraie complicité s'est très vite installée. «Il y a toujours eu quelque chose de chiraquien en Johnny, estime Olivier Mongin. Ce sont deux êtres “ corporels ”, jamais plus à l'aise qu'au milieu d'un groupe en fusion.» Pour le reste, le président et le rocker partagent un destin de survivant, le sens de l'humour un brin potache et un penchant certain pour la bière mexicaine. C'est ce qui l'a frappé, Johnny, la première fois qu'il est allé dîner à l'Elysée. «Je me souviens qu'on nous avait servi du coq au vin. Je me souviens surtout que ça ne nous a pas empêchés d'arroser le repas à la Corona!» Il arrive aussi que Jacques Chirac s'en aille dîner, en famille, chez les Hallyday. Laeticia est aux fourneaux, Johnny jamais loin du frigo. Ces derniers temps, toutefois, le président s'est fait un peu plus rare. «Je crois qu'il a du boulot», sourit le chanteur. La révolution, il y a longtemps qu'il en avait annoncé les prémices. Presque malgré lui, comme souvent Robert Hue, lui aussi, a bien connu Hallyday. C'était au Golf Drouot, où le chanteur des Rapaces, tout jeune militant du PC, passait alors l'essentiel de ses soirées. Selon lui, l'influence du rocker sur les convulsions de la société française ne se mesure pas à l'aune d'une conscience politique un peu feignante. «Johnny n'est pas un homme d'engagement, c'est un symptôme», estime-t-il. Un seul exemple: Mai 68. Hallyday lui-même reconnaît qu'il n'y a pas compris grand-chose. La seule manifestation à laquelle il s'est trouvé mêlé, c'est parce qu'il la traversait en Rolls-Royce, carrefour de l'Odéon, au milieu d'une bataille rangée entre étudiants et CRS. «Une Rolls blanche», précise Jean-Pierre Pierre- Bloch. Que Hallyday ait traversé Mai 68 dans le cuir épais d'une limousine importe peu, finalement. La révolution, il y a longtemps qu'il en avait annoncé les prémices. Presque malgré lui, comme souvent. Cinq ans plus tôt, son fameux concert de la place de la Nation avait réveillé toutes les crampes de la société française. «Dans la France des années 1960, où les enfants ne parlaient pas à table, où, dans les usines, les contremaîtres tyrannisaient les ouvriers, ce fut une déflagration, rappelle Robert Hue. Soudain, la jeunesse s'est rendu compte que l'on pouvait chahuter, casser un peu, bousculer les flics et l'ordre établi. Et que ce n'était pas la fin du monde...» Bien des années plus tard, à sa façon, sans avoir l'air d'y toucher, Johnny, cet homme blessé, ce mari instable, ce père si souvent maladroit, se reconvertira, sur les rivages de la cinquantaine, en chef de tribu modèle au point d'incarner, aujourd'hui, l'archétype triomphant de la famille recomposée. «Je crois qu'il faut remettre les pendules à leur place!» s'était-il exclamé, un jour, dans l'une de ces formules estropiées dont il a le secret. Dans la maison France, le baromètre Johnny, lui, n'a pas bougé. Il n'est pas toujours infaillible. Mais ça fait plus de quarante ans qu'il est là. Au hit-parade des sujets de conversation sur lesquels l'artiste se montre encore moins loquace qu'à l'accoutumée, l'argent détient sans conteste le pompon de l'omerta. C'est l'un des mystères les plus épais de la mythologie Johnny. C'est aussi le secret de son incroyable ténacité. Non pas qu'il soit un milliardaire du disque que l'appât du gain pousse toujours plus loin. Ce serait même plutôt l'inverse. Au terme d'un petit demi-siècle de carrière, le patrimoine de la star ne doit pas excéder celui d'un honnête chef d'entreprise aux portes de la retraite. Les apparences sont trompeuses. Palais, yacht, bolides: tout ce que le rocker possède ne lui appartient pas forcément. Et vice versa. L'été dernier, la Lorada - le Graceland tropézien de Johnny - a été vendue. Les estimations tournent autour de 10 millions d'euros. Mais lui n'a rien touché. Depuis plusieurs années, déjà, Universal Music était le nu-propriétaire de cette somptueuse hacienda. A force de cautions et de garanties bancaires. «Jusqu'il y a deux ou trois ans, Johnny était criblé de dettes, précise Pascal Nègre. Je pense qu'il a fini par se faire peur. Aujourd'hui, la situation est en passe d'être normalisée.» Son fameux goût du défi n'est donc pas la seule explication à sa carrière de dinosaure. «Plus prosaïquement, Johnny a toujours eu besoin d'argent pour rembourser quelqu'un...», souligne le patron d'Universal Music. Quand il évoque, de façon lapidaire, ses innombrables déboires financiers, le chanteur rentre la tête dans les épaules et ses yeux s'étrécissent encore un peu. «J'ai travaillé pendant plus de trente ans pour payer mes arriérés d'impôts, résume-t-il d'une voix lasse. Je n'ai connu que ça: 50 millions de francs de dettes devant moi. Plus les années passaient, moins je m'en sortais. Aujourd'hui, ça va mieux. Je n'ai pas une fortune à la banque. Mais, au moins, je ne dois plus rien à personne.» La saga remonte donc à la nuit des temps. A la fin des années 1960, précisément. «Comme d'habitude, il a eu le tort de faire confiance à une vague connaissance, soupire Pascal Nègre. Le genre de type qui vous propose de toucher 50% de ce que vous gagnez et de payer les impôts à votre place.» Le problème, c'est que Johnny est le genre de type à dire: «Tope là!» Son pote Marc Francelet connaît bien la chanson: «S'il avait voulu, depuis le temps qu'il se fait arnaquer, Johnny aurait pu envoyer une bonne dizaine de soi-disant copains en prison.» La plaisanterie a duré cinq ans. Cinq ans sans payer d'impôts, pour le contribuable Hallyday, c'est énorme. Et puis il y a les intérêts, les pénalités de retard, les emprunts et le train de vie d'une rockstar qu'il faut bien continuer d'assumer. Car Johnny est un flambeur qui ne s'est jamais renié. Le spécialiste de l'achat coup de cœur et du cadeau surprise. Ces derniers temps, la mode est aux écrans plasma - il les offre à la chaîne - auparavant, c'était les Harley - «Un matin, il m'en a fait livrer une, parce qu'il ne supportait pas de me voir rouler à scooter», explique son producteur Jean-Claude Camus. Pour faire bonne mesure, il faut préciser que la propension du rocker à s'entourer de joyeux saltimbanques ne s'est jamais démentie. Une manie qui va de pair avec les purges cycliques auxquelles il procède, la mort dans l'âme. Dernièrement, c'est Joël Devouges, son factotum depuis 1982, qui en a fait les frais. Dans la galaxie Hallyday, l'homme était chargé des impôts, des anniversaires et de l'entretien du parc de motos… Au fil des décennies, le chanteur a également démontré une constance assez remarquable dans l'investissement foireux - immobilier outre-mer, cantines mexicaines, etc. - qui l'a mené plusieurs fois, comme plaignant ou non, devant les tribunaux. Voilà pourquoi, pendant des lustres, Jean-Claude Camus s'est usé à serrer les boulons. Voilà pourquoi sa maison de disques ne compte plus les avances consenties. Voilà pourquoi, enfin, l'idole, qui, selon Pascal Nègre, «assure à lui seul, dans les grandes années, 1,5% du marché musical français et 4% du chiffre d'affaires d'Universal Music», n'a jamais été en position de force au moment de renégocier ses contrats. C'est le cas en ce moment. Par un curieux clin d'œil du destin, les deux demi-frères de Johnny, Jean-Christophe et Olivier, les fils de sa maman, Huguette, sont percepteurs. «Hélas…», sourit l'aîné célèbre. Dur métier, aussi, que de faire tourner, sans relâche, la planche à billets. Car si, sur scène, Johnny mouille le tee-shirt, il le commercialise dans la coulisse. Il est le roi incontesté du merchandising. L'empereur du gadget à Jojo. Ligne de vêtements, fournitures scolaires, parfums, bijoux, statuettes à son effigie… Au fil des années, les tournées de Johnny ont pris des faux airs de caravane publicitaire du Tour de France. Une aubaine: le noyau dur de ses fans est estimé à 150 000 personnes. Seul Bruel, à sa grande époque, a pu rivaliser. Avec Johnny, la grande époque dure depuis quarante ans. Autre particularité du système Hallyday: l'artiste prélève des droits d'auteur et d'édition sur des chansons dont il n'écrit ni les paroles ni la musique. Pascal Nègre ne s'étend guère sur le sujet: «C'est comme ça. Quand Hallyday interprète une chanson, ce n'est pas pareil que si c'est Bertrand Fouinard qui la chantait.» Certes. Il arrive, toutefois, que l'obsession du business pousse l'artiste à la fausse note. Johnny va trop loin. Johnny, à l'inverse de beaucoup d'autres, n'a jamais cherché à devenir citoyen suisse ou résident monégasque A Las Vegas, par exemple, en 1995. Conçu par son entourage comme une usine à dollars, le concert, qui se voulait «historique», demeure l'un des fiascos les plus douloureux du chanteur. Une litanie de nouvelles chansons pour justifier la sortie d'un album live. Les fidèles ont fini par pardonner, mais Johnny, lui, s'en veut encore. En mai dernier, quand les dirigeants d'Optic 2000 lui ont présenté le story-board du spot publicitaire qui inonde actuellement les écrans de télé, le chanteur n'a rien trouvé à redire à son rôle de vieux briscard des casinos, un brin presbyte. A un détail près: «Euh… je crois que ça serait mieux si la scène se situait, en France, sur la Côte d'Azur…» Dans le scénario original, bien sûr, l'histoire se déroulait à Las Vegas. Sans sa naïveté en affaires, sa crédulité face aux profiteurs, son art de gagner beaucoup et de dépenser encore plus, bref sans ce que Jean-Pierre Pierre-Bloch définit comme un «rapport dématérialisé à l'argent», Johnny - qui toucha son premier cachet à 13 ans - aurait pu prendre sa retraite à l'âge où les autres se lancent dans la profession. Mais il était écrit que, sur cette question, son fameux instinct le trahirait toujours, le condamnant, bon gré, mal gré, aux travaux forcés. Jean-Pierre Pierre-Bloch se souvient d'une virée dans les boîtes de Londres, en 1963, en compagnie de Johnny et de Mick Jagger. Au bout de la nuit un type s'accroche à eux, un vrai tenace, une sangsue. «Homo, camé, incompréhensible, résume Pierre-Bloch. Il bégayait qu'il était peintre, voulait qu'on visite son atelier sur les bords de la Tamise. Il nous a eus à l'usure: on l'a suivi…» L'homme vivait effectivement au milieu des toiles. Des toiles étranges sur lesquels dansaient des corps désarticulés. Il en a refilé une à Johnny. Bon débarras. C'est en descendant les Champs-Elysées, vingt ans plus tard, que Jean-Pierre Pierre-Bloch a eu un flash. Une affiche annonçait une exposition au Grand Palais. Il s'est rué chez lui pour appeler son pote: «Johnny, tu te souviens, le peintre à Londres, l'emmerdeur… - Euh, ouais… - C'était Bacon! Francis Bacon! - Ah! ouais… - Tu sais combien ça vaut, un Bacon? Dans les 3 millions de dollars! Elle est où, sa toile? - J'en sais rien, moi… Je l'ai paumée. J'ai dû la balancer dans un déménagement… - T'es sérieux, là? - Jean-Pierre, est-ce que j'ai l'air de plaisanter?» En faisant le bilan de ses multiples infortunes, on ne peut s'empêcher de remarquer que Johnny, à l'inverse de beaucoup d'autres, n'a jamais cherché à devenir citoyen suisse ou résident monégasque. «C'est un petit miracle, en effet», sourit Pascal Nègre. Quand on lui rapporte ce type de réflexion, le chanteur serre les mâchoires et vous transperce de deux flèches couleur azur. C'est la tête qu'il prend lorsqu'il interroge, faussement inquiet: «Est-ce que j'ai l'air de plaisanter?» La tête qu'il avait probablement un soir qu'il arborait sur son perfecto la Légion d'honneur remise par Jacques Chirac et qu'un inconscient, dans une boîte de nuit, le traita de «conformiste légionné», juste avant d'aller méditer à l'infirmerie. Johnny, donc, l'ancien gamin sorti de nulle part, ne transige pas avec sa fierté d'être français. Il le dit avec des mots de vieux sage, sur un ton courtois mais définitif: «Je n'oublie jamais que la France est mon pays. Je l'oublie même de moins en moins. Quand je suis revenu de tout, il ne me reste que ça. Même les Etats-Unis m'ennuient. Au bout de trois semaines, désormais, je n'ai qu'une envie: rentrer en France. Ici, c'est chez moi.» Le romancier Vincent Ravalec, qui lui écrivit une chanson dans l'album Sang pour sang, se souvient du jour où il comprit que Johnny incarnait la «quintessence du pays». A la télévision, un journaliste avait demandé au chanteur s'il fallait «virer les ploucs de Saint- Tropez». Avec une simplicité non feinte, Johnny avait décoché cette fulgurance: «D'abord, je trouve insultant de m'avoir dérangé pour me poser cette question. Ensuite, ce ne sont pas des ploucs, c'est mon public!» Le soir, chez les Hallyday, tout le monde dîne à la cuisine, chacun à sa place, autour des deux mamies A l'usure, Johnny a conquis tous les publics. Etre fan de Hallyday est, aujourd'hui, du dernier chic chez les intellectuels les plus intransigeants. Philippe Caubère, héritier du théâtre d'Ariane Mnouchkine, ne jure que par lui: «J'ai tout copié sur lui, y compris son attitude sur scène», assure-t-il. Lynda Lemay, la chanteuse québécoise, égérie des bobos quadragénaires, le tient pour unique référence: «Je lui ai consacré l'une de mes chansons après l'avoir rencontré, précise-t-elle. D'ailleurs, j'ai ma carte d'adhérente à son fan-club.» Et les «ploucs», dans tout ça? Cela fait bientôt quarante ans qu'ils chantent le même refrain: Jojo, on t'aime! L'antidépresseur est si puissant qu'on a songé à le rembourser, récemment, aux plus démunis. Fallait-il que les villes qui accueilleront la tournée 2003 de l'artiste «subventionnent» une partie du spectacle en achetant quelques milliers de places à près de 50 euros pour les redistribuer aux chômeurs et aux RMIstes? Le projet a déclenché une bataille rangée dans les conseils municipaux, notamment à Bordeaux. Johnny, meurtri par la polémique, ne veut plus en entendre parler. Tout n'est, pourtant, pas perdu pour ses inconditionnels sans le sou. Car, quand le vrai Johnny, à force de gigantisme, devient inaccessible, il reste Denis Lemen, alias Johnny Rock, le sosie «officiel» de l'idole. Vingt et un ans de carrière, 130 galas par an. Des filles font, parfois, 300 kilomètres pour le voir imiter son modèle. «Il y en a même qui dorment sur le palier de ma chambre d'hôtel», glisse-t-il au passage. On lui offre des fleurs, des montres. Il a, lui aussi, sa ligne de produits dérivés: le polo à manches courtes et le ciré Johnny Rock. Bien sûr, c'est un Johnny placebo. Il le sait. Mais, dans sa catégorie, il est le meilleur. Le plus grand. De la centaine de sosies qui ont, un jour, attaqué le marché, tous, même les plus talentueux - on pense ici à Johnny Vegas, voire à Jojo Daytona - s'y sont cassé les dents. Johnny Hallyday, le seul, l'unique, le tatoué, va donc avoir 60 ans et, tous sentiments confondus, c'est plutôt rassurant de vieillir avec lui. «Dans un monde qui change très vite, on a besoin de choses qui durent», souligne Pierre Sansot. La chose - que l'écrivain Daniel Rondeau, auteur d'une biographie intitulé Johnny (Nil), range entre de Gaulle et Tintin au rayon des mythologies françaises - est, aujourd'hui, en voie de canonisation. On devine que l'empressement collectif de la critique à le louer, au terme d'un parcours épique, d'une alternance hors normes de jouissance et de souffrance, le laisse moins goguenard qu'il n'y paraît. Voilà deux semaines, la fille de Johnny et de Nathalie Baye, Laura, 19 ans, jeune comédienne, a téléphoné à son père avec des sanglots dans la voix. Elle posait à la Une de Paris Match et trouvait la photo «horrible». Johnny lui a gentiment, mais fermement, remis les idées en place: «Dis donc, ma chérie! Je te rappelle qu'en cinquante ans de carrière M. Charles Aznavour n'a jamais fait la couverture de Match...» Le respect des anciens, c'est sacré. Johnny Hallyday ne sera jamais le Faust de la scène rock, un dieu païen repu de gloire, de femmes et de cynisme. C'est un homme viscéralement simple, attaché aux valeurs, et dont la vie, ces derniers temps, à la Savannah, ressemble plus à une chanson de Francis Cabrel ou aux petits bonheurs chers à Philippe Delerm qu'à l'hymne barbare si souvent entonné en son honneur. Le soir, chez les Hallyday, tout le monde dîne à la cuisine, chacun à sa place, autour des deux mamies: Huguette, la maman de Johnny, handicapée, et Mamée, l'arrière-grand-mère de Laeticia. Le linge de table est provençal, il y a des fleurs dans les vases, quatre chiens dans le jardin, des discussions à n'en plus finir sur le choix de la sauce pour les spaghettis, et des voisins - Paul Belmondo, Catherine Lara, Hugues Aufray - qui passent saluer la famille. Le dimanche, il y a aussi Laura, David et ses filles, à qui Laeticia apprend à faire des gâteaux, et Johnny, qui lance, en savourant son effet: «Finalement, je suis une sorte de patriarche!» Ticky Holgado assure que Laeticia est un miracle pour Johnny: «Elle ne veut pas devenir comédienne ou chanteuse. C'est la première que je n'entends pas dire “Johnny” ou “Jojo” quand elle parle de lui, mais “mon mari”.» Quand le parolier Michel Mallory, vieux compagnon de route du rocker, a décidé de se marier, Johnny a passé la future épouse à la question. En tête à tête, pendant une heure. «Puis il m'a donné sa bénédiction», s'amuse le mari. Quand on lui demande - bêtement - ce qu'il aimerait qu'on dise de lui après sa mort, le chanteur répond d'une voix sereine: «Il a cru en ce qu'il a fait.» Il n'a pas fini d'y croire. Et nous avec. Il y a dix mois, sur le rallye Paris-Dakar, son équipier René Metge a découvert un homme qui pouvait conduire six heures d'affilée dans le désert sans prononcer le moindre mot. Avant de lâcher le fond de ses pensées: «Tu vois, René, je réfléchissais au concert de mes 60 ans. Je me vois bien débarquer au Parc des princes au volant d'un bolide, façon Mad Max, dans un décor de dunes…» Finalement, le chanteur a choisi de descendre du ciel. Il arrivera sur scène par la voie des airs, «suspendu à 68 mètres du sol», confie-t-il dans un sourire de môme un peu casse-cou. C'est tout pour aujourd'hui. Son portable retentit. Il s'excuse. Se lève. Allume une gitane - il ne fume que des gitanes, comme Gainsbourg. Au bout du fil, l'ami Carlos. Johnny répond, l'air grave: «Faut qu'on se voie le plus vite possible.» Une urgence? Johnny confirme: «Il a découvert un nouvel épicier dans le Marais. Il paraît qu'il y a des piments à tomber…» par Henri Haget et Gilles Médioni |
|